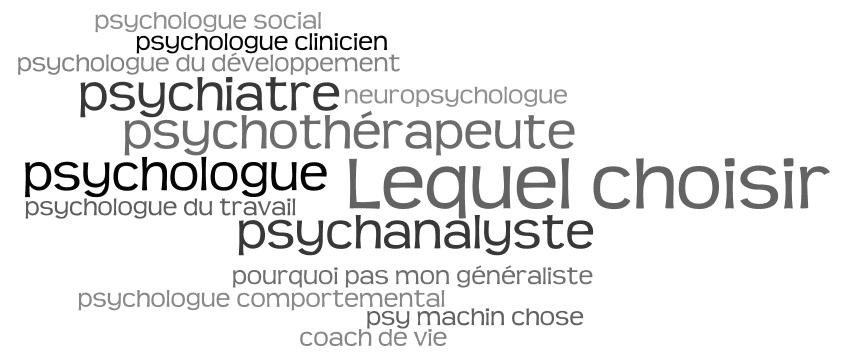Le zoom de l’appareil photo et le « zoom attentionnel » de l’humain
- Observons le fonctionnement du zoom d’un appareil photo : Le même appareil peut permettre de regarder les choses de façon très nette de près, ou bien de voir les choses de loin et donc avec plus d’objets (ou de motifs) dans la photo, mais sensiblement moins de précision sur les détails.
- De façon similaire, chaque être humain est muni d’une fonction de « Zoom attentionnel » :
- Lorsque le zoom est au maximum, la personne est focalisée, et hyperconcentrée sur une tâche.
- Lorsque la personne « dézoome », elle peut réaliser (se rendre compte) qu’une autre tâche est possible, et elle peut alors basculer sur cette seconde tâche, ou sur une troisième.
- Puis elle peut « rezoomer » et se focaliser à nouveau sur une autre tâche, ou bien revenir à la première.
- Il y a des personnes qui ont une facilité à se concentrer et à ne pas être distrait par des stimuli extérieurs, et d’autres personnes qui ont moins cette facilité. Cette capacité est donc située sur un « continuum ». On peut imaginer que pour chacun(e), le curseur se déplace sur ce continuum, comme lorsqu’on règle le zoom d’un appareil photo.
- Pour simplifier, on peut imaginer que le diagnostic de TDA/H se situe à l’extrême de ce continuum : la personne a du mal à se concentrer, à se focaliser, et son attention passe trop facilement d’une tâche à l’autre, d’un sujet à l’autre. On constate d’ailleurs chez ces personnes une forme de capacité à être « multitâches ». Cette capacité est intéressante, mais parfois elle se fait au détriment d’une réalisation précise des tâches.
- Il y a des personnes qui ont certains symptômes du TDA/H sans pour autant que l’on puisse leur attribuer la présence d’un « TDA/H », c’est-à-dire qu’il n’auront pas ce diagnostic car l’ensemble de leurs troubles sera considéré comme « insuffisant » par rapport à la norme.
- Par exemple, une personne peut avoir des troubles de la concentration, mais ce ne sera pas suffisant pour pouvoir la diagnostiquer comme « TDA/H ».
Le verrou dopaminergique : une clé de compréhension du TDA
- Selon le Dr Jean-Baptiste Alexanian, le TDA/H porte mal son nom, parce qu’il est circonstanciel : il dépend de circonstances, et notamment du « verrou dopaminergique ».
- Lorsqu’il n’y a pas de plaisir, le verrou est fermé, et il y a alors une augmentation de l’impulsivité, et une augmentation de la distractivité.
- A contrario, lorsque le verrou est ouvert, il y a beaucoup plus de capacités attentionnelles.
- Pour que le verrou soit ouvert, il faut qu’il y ait :
- du plaisir
- pas de stress
- Pour que le verrou soit ouvert, il faut qu’il y ait :
- Chaque individu souffre donc de ce trouble en fonction de son propre plaisir et ses propres envies, c’est-à-dire que là où il n’y a pas de plaisir, il y aura des troubles attentionnels.
- Donc, par exemple : si on prend deux individus ayant un TDAH, et qu’on les place dans une même circonstance, il se peut qu’ils réagissent de façon très différente : celui qui aura peu de plaisir dans cette circonstance (verrou fermé) verra son trouble se manifester, tandis que pour l’autre qui aura du plaisir à être dans cette circonstance (verrou ouvert), le trouble ne se manifestera pas !!
Le méthylphénidate
- Le méthylphénidate est le traitement recommandé dans le traitement du TDA/H. C’est un médicament de la famille des psychostimulants (comme les amphétamines).
- Le méthylphénidate agit pendant quelques heures, puis son action disparaît rapidement.
- Son action se situe sur les niveaux de dopamine notamment dans le striatum : il permet de conserver un niveau de dopamine plus important entre les neurones, ce qui facilite le passage de l’information.
- Si on reprend la métaphore du verrou dopaminergique, le méthylphénidate permet de « balancer » les niveaux de dopamine, et il permet d’ouvrir le verrou.
- Cela va permettre à la personne d’anticiper une récompense et un plaisir plus important que ce qu’elle aurait eu sans traitement : sans le traitement, la personne n’aurait pas eu envie, et ça n’aurait pas été pour elle.
- La personne va pouvoir faire plus de choses, y compris des choses qui ne l’intéressent pas, parce que son cerveau va mieux contrebalancer.
- Par exemple : à l’école, il y a une partie importante d’enfants avec un TDAH qui ne trouvent pas de plaisir à apprendre certaines choses, parce que ça ne les stimule pas assez, ou parce que ce n’est pas expliqué de la manière dont ils aimeraient que ce soit, ce qui fait qu’il n’y a pas de « génération de plaisir » : dans ces situations, le verrou dopaminergique est fermé ; ils sont distraits, impulsifs, ils n’arrivent pas à se concentrer.
- Le traitement leur permet d’être plus attentifs, un peu moins distractibles, un peu moins impulsifs, donc un peu plus concentrés, et cela leur permet de favoriser les apprentissages, mais aussi le contrôle émotionnel.
- Autrement dit : Chez les personnes ayant un TDA/H , un problème est qu’en l’absence de plaisir, ou sous stress, le verrou dopaminergique est fermé, et la personne est moins capable que les autres d’anticiper quelque chose de positif de ce qu’elle va faire. Le seuil de plaisir n’est pas atteint.
Avec le traitement, il y a un rééquilibrage de la balance entre contrainte et plaisir, et cela permet alors de faire des choses qui sont parfois très importantes, comme par exemple la scolarité.
Conclusion sur l’apport de la médication dans le TDA/H
- Le traitement au méthylphénidate est EFFICACE, parce qu’il ouvre le verrou dopaminergique et qu’il améliore le fonctionnement des fonctions exécutives : Cela permet à la personne d’être plus « centrée » et donc d’obtenir un gain de focalisation, de concentration, et un moindre « éparpillement » dans ce qu’elle fait. De plus, les idées négatives sont mieux contrôlées par le cerveau, qui « trie » mieux les idées, cela permet une meilleure protection contre l’anxiété, la déprime (voire même la dysthymie qui est une forme de dépression chronique) très présente chez les personnes ayant un TDA/H.
- La psychothérapie peut se greffer par-dessus la médication, de manière à permettre la mise en place de stratégies, et pouvoir ainsi augmenter la capacité de la personne à réussir ses actions.
Les psychostimulants
- Ils comprennent les produits :
- à base de méthylphénidate (Ritaline, Concerta, Medikinet, Quasym).
- et les produits dérivés des amphétamines (Xurta en France, et Adderall et Vyvanse)
- à base de méthylphénidate (Ritaline, Concerta, Medikinet, Quasym).
- Les psychostimulants ont démontré leur efficacité, qui dure quelques heures
Libération immédiate (LI) et Libération prolongée (LP)
Certains médicaments peuvent avoir une conception (galénique) plus adaptée à une libération progressive de la molécule : c’est ce qu’on appelle la libération prolongée. Par exemple, il existe la Ritaline LI (Libération immédiate) et la Ritaline LP (Libération prolongée). L’effet d’un comprimé de Ritaline LI (libération immédiate) dure environ 4 heures, tandis que l’effet d’un comprimé de Ritaline LP (libération prolongée) dure environ 8 heures. L’utilisation de la Libération prolongée est donc préférable pour un effet bien étalé sur la journée, et sans trop de variations.
Par exemple, au lieu de prendre un comprimé de Ritaline LI le matin et un comprimé de Ritaline LI en début d’après-midi, la personne peut prendre seulement un comprimé LP le matin. C’est non seulement plus pratique, mais c’est aussi meilleur pour le corps et l’humeur.
Mise en place du traitement au méthylphénidate
Il est à noter que la tolérance aux médicaments à base de méthylphénidate varie selon les personnes. Pour un début de traitement, il est FORTEMENT recommandé de commencer par une dose basse de 10 mg, puis d’augmenter les doses progressivement au fil du temps. En effet, si la dose de méthylphénidate est trop forte, des maux de tête peuvent advenir de manière passagère en début de traitement.
Normalement, le psychiatre doit mettre en place un protocole d’augmentation progressive : par exemple 10 mg la première semaine, puis 20 mg la deuxième semaine, puis 30 mg la troisième semaine, etc. Et ce jusqu’à ce que le patient arrive à un équilibre personnel en termes d’effets, avec le minimum d’effets secondaires.
N’hésitez pas à poser des questions à votre médecin psychiatre.
Les médicaments non stimulants
- Cependant, certaines personnes ne répondent pas beaucoup aux psychostimulants. Ces personnes peuvent se voir prescrire des non-stimulants : un antidépresseur (Strattera), un antihypertenseur (Intuniv) ou un antipsychotique.
- Enfin, il est possible d’adopter un double traitement, un composé de stimulants et de non-stimulants. Cela peut être très efficace.
Dernière Mise à jour : 8 octobre 2025